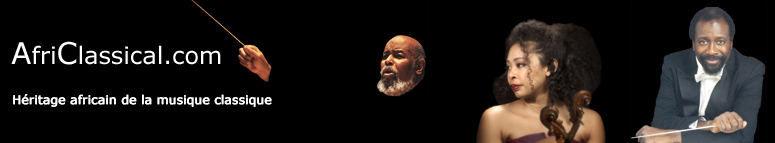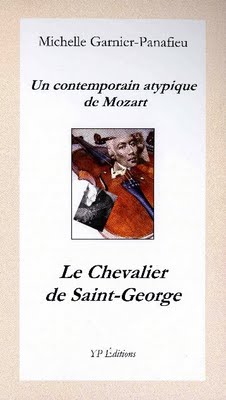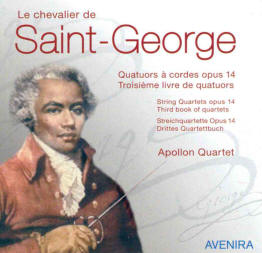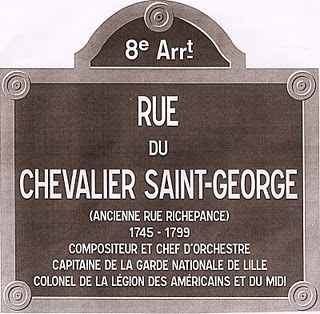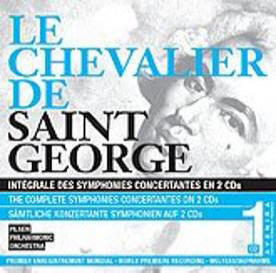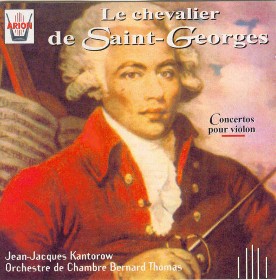Accueil-> Compositeurs ->
Saint-Georges, Le
chevalier de
English
Le
chevalier de
Saint-Georges (1745-1799)
Compositeur
afro-français,
Violoniste, chef d'orchestre
Virtuose du fleuret, Chef de brigade
|
|
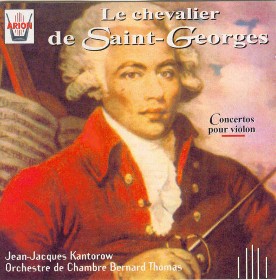
Concertos pour violon, Op.
5, Nos. 1 &
2; Op. 3, No. 1; Op. 8, No. 9
Jean-Jacques Kantorow, violon
Orchestre de Chambre Bernard Thomas
Arion 68093 (1990)
Nous vous présentons une
nouvelle version de notre biographie du chevalier de
Saint-Georges.
Les pages qui mentionnent les CD et l'article sur Gian
Faldoni, rival de Saint-Georges au fleuret, ont des
liens en haut de la page.
Si vous souhaitez lire d'autres développements sur
le chevalier de Saint-Georges, écrits pas Daniel
Marciano, vous pouvez visiter son site:
www.chevalier-de-saint-georges.fr
|
|
Table des Matières
1
La Redécouverte
2 Les CD
3 Les Biographies
4 Annales Historiques
5 La Naissance
6
La fuite
7 L'enfance
8
L'académie d'escrime
9 Ecuyer
10 Le recensement des Noirs en France
11
Les Parisiens Noirs
12 Le Testament du père
13 L'escrimeur
14 L'athlète
15 Picard et Faldoni
16 Le Concert des Amateurs
17 Violoniste et Compositeur
18 La Direction d'orchestre
19 L'Opéra de Paris
20 Intrigue
21 « Le Don Juan Noir »
22 Le Théâtre Musical
23 L'Apogée de sa carrière
24 La Reine
Marie-Antoniette
25 Embuscade nocturne
26 Un inspecteur de police
27 « Erreur sur la personnel »
28 Le Concert de « La Loge Olympique »
29 Concert pour clarinette
30 La Chevalière d'Éon
31 L'influence de Voltaire
32 « Les Symphonies Parisiennes »
33 Les Amis des
Noirs
34 La Révolution Française
35 La Légion
Saint-George
36 Le 13e Régiment de Chasseurs
37 La Trahison de Dumouriez
38 Prisonnier
39 Saint-Domingue
40 Le Cercle de l'Harmonie
41 Anne Nanon retrouvée!
42 La mort du Chevalier
43 L'exhumation
44 Les annonces nécrologiques
45 L'Esclavage
46 Le Verdict de l'histoire
47 Rue du Chevalier Saint George
48 Documentaire : « Le Mozart Noir »
49 L'Association des Amis de Joseph
Bologne, chevalier de Saint-Georges
50 Les Partitions
51 Bibliographie
52 « Un contemporain atypique de
Mozart »
|
|
« Un contemporain atypique de Mozart : Le
Chevalier de Saint-George » ; Michelle
Garnier-Panafieu; YP Éditions (2011).
Table des Matières,
No
51.
Échantillons audio :
1 « Chevalier de Saint-Georges: String
Quartets » ;
Coleridge String Quartet ; AFKA
SK-557 (2003) Quatuor à cordes, N°
3
(Période 5:03)
2 Cedille 90000 035 (1997) ; « Violin Concertos
By Black Composers of the 18th & 19th
Centuries »
;
Rachel Barton, violon ; Encore
Chamber Orchestra ; Daniel Hege, Conductor
Concerto pour violon, Op.
5, N° 2 en la majeur
Pour les échantillons
additionnels, voyez la page Audio ou les pages sur les
Concertos pour violon, les Symphonies et les Quatuors à
cordes.
« Créole dans le Siècle des Lumières
»
1 La Redécouverte
Après deux siècles d'oubli, nous assistons à une
« renaissance » de Joseph de Bologne, appelé aussi Le
chevalier de Saint-Georges, l'un des plus remarquables
personnages du XVIIIe siècle. Il est difficile de penser
que ce fils d'esclave d'ascendance africaine par sa mère,
ait pu gravir tous les échelons de la société française
grâce à sa maîtrise du violon et de
l'escrime ! Le portrait ci-dessus où il apparaît habillé
avant un concert, tenant un fleuret à la place d’un bâton de
chef d'orchestre, illustre sa double carrière. Ce tableau a
été peint en 1787 par un artiste américain du nom de Mather
Brown.
2 Les CD
Les liens en haut à gauche mènent à des sélections de
CD, des extraits de livrets d’albums et d’échantillons audio
dans quatre catégories : des Concertos pour violon, des
Symphonies, des quatuors à cordes et des Sonates pour
clavecin.
Les concertos pour violon comprennent Monsieur de
Saint-George : Quatre Concertos pour violon, Calliope
9373 (2007) par Les Archets de Paris.
Parmi les Symphonies nous avons la bande son du DVD Le
Mozart Noir.
Les CD des quatuors à cordes d’Antares, Apollon, Coleridge
et Jean-Noël Molard sont mentionnés.
Le récent CD d’Anne Robert Les Dix Sonates pour clavecin
a été choisi parmi les enregistrements de cet instrument.
3 Les Biographies
Cet essai se réfère à
quatre livres biographiques sur Saint-Georges :
(1) Joseph Boulogne, nommé Chevalier de Saint-Georges
(1996) par Emil F. Smidak, versions anglaise et française.
(2) The Chevalier de Saint-George: Virtuoso of the Sword and
the Bow (2006) par Gabriel Banat.
(3) Le chevalier de Saint-George (2004) by Claude Ribbe
en français.
(4) Joseph de Saint-George, le Chevalier Noir (2006) par
Pierre Bardin.
4 Annales historiques
Le professeur Luc Nemeth a fait une
communication dans les Annales historiques de la Révolution
francaise – n° 339, janvier 2005, pp. 79-97 : Un
État-Civil Chargé D'Enjeux : Saint-George, 1745-1799 –
qui précise la date de naissance du Chevalier et sa filiation.
Saint-Georges est né le 25 décembre 1745 et son père est Georges
de Bologne Saint-Georges, propriétaire d’une plantation au
Bailiff.
Luc Nemeth mentionne qu’Odet Denys dans son livre Qui était
le chevalier de Saint-George – Paris : Le Pavillon, 1972 –
est le premier à avoir avancé cette filiation, sans toutefois
que son affirmation soit corroborée par des preuves.
Luc Nemeth précise que « le caractère lacunaire des archives
anciennes de la commune du Baillif (Guadeloupe) et la naissance
illégitime de Saint-George, enfant naturel d'une esclave,
expliquent en partie le flou qui a pu entourer l'état-civil de
celui-ci : trois dates de naissance différentes ont pu lui être
attribuées, non sans quelque bien-fondé pour chacune. »
5 Naissance
Le père de Joseph de Bologne s'appelle donc Georges de Bologne de Saint-Georges, riche planteur et membre d'une
famille qui vit aux Antilles, dans la colonie française de
la Guadeloupe, depuis 1645.
Le 8 septembre 1739, Georges de Bologne épouse Elizabeth
Merican et en janvier 1740 fait l'acquisition d'une
plantation de 50 hectares avec 60 esclaves.
Anne, appelé aussi Nanon, l’une des jeunes esclaves de la
plantation, née sur l'île, âgée de 17 ans, et Georges ont un
fils qui vient au monde en 1745 et par un heureux présage le
25 décembre.
Selon les lois en vigueur de l'époque, même reconnu par son
père - nobliau français qui sera plus tard titulaire d’une
charge de gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi - cet
enfant dont la mère est une esclave africaine ne pouvait, au
départ, espérer appartenir au corps de la noblesse.
6 La fuite
Le 17 décembre 1747, Georges de Bologne qui passe la soirée sur la
propriété de son oncle Samuel, en vient à se battre en duel
avec Le Vanier de Saint-Robert, l’époux d’une cousine, au
cours d’une soirée où les convives ont fait ample
consommation de
« ponche ». Le Vanier est blessé et meurt quelques jours
plus tard.
Georges de Bologne juge préférable de quitter la Guadeloupe
en secret afin de se soustraire à des poursuites judiciaires
pour homicide. Le 31 mars 1748, il est condamné à mort par
contumace pour assassinat et à la confiscation de ses biens.
Chose surprenante, pour empêcher que Nanon et Joseph, ne
soient vendus, Elizabeth, son épouse, quitte l'île avec
Nanon, son fils et un esclave nommé François en déclarant,
titres à l'appui, que ce sont ses serviteurs. Joseph
célèbre son troisième anniversaire en mer et arrive en
France le 4 janvier 1749.
Le clan familial des Bologne va user de son influence auprès
de la Cour pour que George obtienne la grâce du Roi Louis XV.
Joseph et ses parents peuvent alors retourner aux Antilles
le 2 septembre 1749. Le manifeste du navire mentionne que
Georges est âgé de 38 ans, Nanon de 26 et Joseph de 3 ans.
7 L'enfance
Joseph est un enfant privilégié sur la plantation.
Il a le temps de jouer et son père lui enseigne la musique
et l'escrime. Quand il a huit ans, Joseph voyage vers
Bordeaux avec Elizabeth pour aller à l'école et arrive en
France le 12 août 1753. Nanon et Georges débarquent à
Bordeaux le 19 septembre 1755 et retrouvent Joseph à Paris
qui va vivre avec eux dans le quartier huppé de
Saint-Germain.
8
L'académie d'escrime
La vie de Joseph change radicalement
l'année suivante. En octobre 1756, il est admis à
l'académie d'escrime de Nicolas Texier de La Böessière, qui
accueille quelques jeunes aristocrates comme pensionnaires.
Dans cette académie, au cours de la matinée, les élèves
suivent des cours de mathématiques, d'histoire, de langues
étrangères, de musique, de dessin et de danse.
On consacre l'après-midi a l'escrime, discipline importante
entre toutes. L'entraînement d'équitation a lieu aux
Tuileries sous la direction d'un maître écuyer.
Dans l’avant-propos d’un traité d'armes, publié en 1818, La
Böessière fils, prénommé Antoine, consacre quelques pages à
son ami Joseph et écrit que Saint-Georges est « l'homme le
plus prodigieux qu'on ait vu dans les armes ».
9 Ecuyer
Pierre Bardin nous apprend que le 10
mai 1763, Georges achète pour son fils « l’Office d’Ecuyer,
Conseiller du Roy, contrôleur ordinaire des guerres » et le
8 juin en la Grande Chancellerie de France, les magistrats
donnent officiellement leur agrément à cette vente.
Cette charge lui permet de prendre le titre d’écuyer. Joseph
est alors âgé de dix-sept ans et quatre mois alors que l’âge
légal pour exercer cet office est de 25 ans.
Une dispense lui a donc été octroyée. Pierre Bardin présume
que son père a fait jouer à plein l’article 59 du Code Noir
selon lequel « les affranchis ont les mêmes droits,
privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées
libres ».
Saint-Georges occupera cette charge durant onze années. Cela
peut expliquer pourquoi, lorsque l’on décrétera que la
Patrie est en danger, au cours de la Révolution, le
Ministère de la Guerre confiera à Saint-Georges le
commandement d’un régiment de cavalerie légère.
Luc Nemeth est le premier à mentionner - c'est là une
précision biographique inédite - que le chevalier de
Saint-Georges sera inscrit sur les registres des gendarmes
de la garde du Roi le 15 juin 1764 et non en 1761 comme on
le pensait précédemment.
10 Le
recensement des Noirs en France
Le nombre croissant d'hommes de couleur en
France incite le gouvernement à limiter et canaliser
l'immigration. Le « Code
Noir » qui régit les rapports entre maîtres et esclaves est
en vigueur depuis le XVIIe siècle. Le 5 avril 1762, le roi
Louis XV décrète que les nègres et gens de couleur doivent
se présenter au greffe de l'Amirauté dans un délai de deux
mois. Nanon s'y présente et La Böessière se charge de
l'inscription de Joseph, son protégé, pour lui éviter le
désagrément de comparaître devant les responsables de
l'Amirauté.
Sur cet acte de recensement en date du 10 mai 1762, retrouvé
par Gabriel Banat, Anne Nanon a déclaré être âgée de 34 ans.
En outre, nous apprenons que 159 personnes ont ainsi été
recensées.
11 Les
Parisiens Noirs
Pierre Bardin explique dans sa
biographie de quelle façon Saint-Georges et d’autres Noirs
parviennent à surmonter l’obstacle du racisme et à s’insérer
dans la classe moyenne. Il souligne que sans nul doute
Saint-Georges était un être supérieurement doué et
talentueux mais que ses dons innés ne lui auraient pas
permis de réussir dans toutes ses entreprises sans un
travail constant. C’est à ce seul prix qu’il atteindra
l’excellence, suscitera l’admiration et parviendra à
surmonter les préjugés raciaux qui le plaçaient
dédaigneusement dans la catégorie des mulâtres.
Pierre Bardin cite plusieurs cas de Parisiens d’ascendance
africaine insérés dans la société parisienne ou provinciale.
Il mentionne notamment un certain André Lucidor, un esclave
de l’île de la Martinique, affranchi en 1750, qui venu en
France, devient maître d’armes, ouvre une salle à
Ménilmontant, épouse une femme blanche avec qui il a des
enfants. Bien que les mariages interraciaux soient
officiellement interdits, P. Bardin souligne que dans les
faits, force n’est pas donnée à la loi.
12
Le testament du père
Pierre Bardin a retrouvé la copie du testament rédigé par
Georges de Bologne de Saint-Georges en date du 9 décembre
1765, enregistré chez un notaire par lequel il déclare : « Je
donne et lègue à demoiselle Anne Nanon, négresse libre,
attachée à mon service depuis trente années une somme de
trois mil livres. Puis je donne et lègue à Monsieur de
Saint-George, Ecuyer, conseiller du Roy, Controlleur des
guerres, une somme de cinquante mil livres… »
Ce testament prouve l’affection et la considération de
Georges de Bologne pour son fils et Nanon, la mère de son
enfant.
13 L'escrimeur
Joseph étudie à l'académie de La
Boëssière pendant six années jusqu'à l'âge de 19 ans. Tout
le monde l'appelle alors le chevalier de Saint-Georges.
Voici ce que dit Claude Ribbe sur ce personnage
d'exception :
« Que son titre soit porté à bon droit ou non, ce
chevalier passe en tout cas pour inimitable. Dans tout ce
qu'il fait, il excelle et sa réputation naissante l'entraîne
malgré lui à enchaîner les exploits. À dix-sept ans, Joseph
est non seulement un sportif accompli mais, déjà, un homme
public. Connu et reconnu, il pratique avec une supériorité
déconcertante toutes les disciplines artistiques et
sportives auxquelles les jeunes aristocrates négligent de
s'adonner autant qu'ils le devraient…
« Le corps de Joseph étonne ? Il surprendra
davantage quand l'Américain montrera de quelle façon il sait
s'en servir. Avec un sens consommé de la provocation, le
jeune homme fait de ce corps problématique - que les
lecteurs de Voltaire considèrent peut-être comme un produit
dégénéré - l'instrument même de sa gloire. Il se transforme
en un objet admirable auquel, pourtant, il refuse de se
réduire. Car ce n'est pas le corps de Joseph qui commande,
c'est Joseph lui-même. Sa propre chair, il la subjugue
aussi facilement qu'il sait dompter les chevaux les plus
ombrageux. »
Et C. Ribbe ajoute : L'épée étant réservée à la
noblesse, l'apprentissage des armes, sérieusement réglementé
pour écarter les élèves et les maîtres indésirables, est le
fait d'une élite. Figurer parmi cette aristocratie, et à la
première place encore, n'est donc pas rien. Par sa
précellence à l'escrime, Saint-George acquiert une position
d'invulnérabilité à la fois physique et
sociale. »
Le maître Henry Angelo, maître d’armes qui tient une salle
d’armes à Londres, le surnommera plus tard « Le Dieu des
Armes ».
14
L'athlète
« On le voyait souvent traverser la
Seine en nageant d'un seul bras, et au patinage, son adresse
surpassait celle de tous les autres. En tirant au pistolet,
il était rare qu'il manquât son but. », écrit Emil F.
Smidak, auteur d'une biographie intitulée «Joseph
Boulogne nommé Chevalier de Saint-Georges ».
En outre, Saint-Georges est aussi un habile danseur et il
est remarquable à la course.
15
Picard et Faldoni
Quand Saint-Georges a 19 ans, son père
promet de lui offrir un cheval et un cabriolet s'il parvient
à battre maître Picard, un excellent maître d'armes de Rouen
qui a mis en doute l’adresse de Saint-Georges au fleuret.
Saint-Georges l'emporte et bientôt on le voit conduire son
attelage avec adresse dans les rues de Paris.
L'année suivante, Gian Faldoni, un talentueux escrimeur
italien vient à Paris pour défier Saint-Georges. Celui-ci
refuse d'abord mais Faldoni ayant pris le meilleur sur tous
les escrimeurs de Paris qu'on lui a opposés, Saint-Georges accepte de croiser le fer avec lui. Ce spectacle public
attire des aristocrates et de nombreux maîtres d'armes. Les
deux tireurs sont de force sensiblement égale et l'assaut
d'armes est superbe.
Henry Angelo écrira plus tard que ce fut l'Italien qui
l'emporta mais le maître français Posselier, avec une égale
dose de chauvinisme avance que Faldoni fut « bel et bien
battu ». (Voir commentaire de l'assaut
Faldoni-Saint-Georges dans ce site) :
Escrime
16
«
Le Concert des Amateurs »
Saint-Georges maîtrise le violon et le
clavecin. Parmi les compositeurs reconnus qui lui dédient
leurs compositions, on peut noter Antonio Lolli en 1764 et
François-Joseph Gossec en 1766. On pense qu'il a suivi les
enseignements de Jean-Marie Leclair, autre compositeur
important de l'époque et qu'il a étudié la composition avec
Gossec. Saint-Georges prend part à la création du « Concert
des Amateurs » en 1769. Gabriel Banat mentionne qu’il en
devient le premier violon en 1771. C’est Gossec qui a créé
l’orchestre et le dirige.
Claude Ribbe donne la composition de cet orchestre :
« L'ensemble, où se côtoient amateurs et professionnels
de l'Académie Royale de Musique et de la Musique du Roi,
comprend plus de soixante-dix pupitres dont quarante violons
et tailles, douze violoncelles et huit contrebasses,
auxquels viennent s'ajouter les vents : flûtes, hautbois,
clarinettes, trompettes, cors et bassons. »
17
Violoniste et Compositeur
Saint-Georges a composé une sonate
pour flûte et harpe. Lui et Gossec sont parmi les premiers
compositeurs français de quatuors à cordes, de symphonies
concertantes et de quatuors concertants. Ses premiers
quatuors à cordes sont joués dans les salons parisiens en
1772. « Pendant la saison de concerts 1772-1773, Joseph
dirige et joue deux premiers concertos pour violons aux
Amateurs », précise C. Ribbe et le journal Le Mercure
rapporte qu'ils « ont reçu les plus grands
applaudissements tant pour le mérite de l'exécution que pour
celui de la composition. »
Dans le livret du disque Arion 55445 (1999), le violoniste
Joël Marie Fauquet écrit :
« Saint-George a tôt acquis une maîtrise de la technique
et de la sonorité, de telle sorte que son talent moelleux
sur le violon lui faisait quelquefois donner la préférence
sur les plus habiles artistes de son temps...»
18 Direction d'orchestre
Saint-Georges prend la direction du
Concert des Amateurs en 1773, réussissant à mener de front
une carrière de chef d'orchestre et de compositeur. De 1773
à 1775, il compose huit concertos pour violon et deux
symphonies concertantes.
En 1775, deux années après ses débuts de chef d'orchestre,
« L'Almanach Musical » qualifie cet ensemble de «
meilleur orchestre symphonique de Paris, voire d'Europe
».
19
L'Opéra de Paris
Lorsque l’on songe à confier la gestion
de L’Académie Royale de Musique à des investisseurs privés,
Saint-Georges accepte de se porter à la tête d’un groupe de
notables parmi lesquels se trouvaient le fermier général, le
Baron Rigoley d’Ogny et le financier Jacques Necker.
Saint-Georges qui avait fait du « Concert des Amateurs » le
meilleur orchestre d’Europe, apparaît alors comme le
candidat le plus valeureux pour être porté à la tête de
cette prestigieuse institution.
Le baron Von Grimm dans sa « Correspondance littéraire
et philosophique », rapporte que dès que
Sophie Arnould et Rosalie Levasseur, deux chanteuses, et
Marie-Madeleine Guimard, première danseuse de l’Opéra,
eurent été informées de la candidature de Saint-Georges à la
direction de l’Opéra, elles présentèrent un « placet »
(une pétition) à la Reine pour lui faire savoir que «
Leur honneur et la délicatesse de leur conscience ne leur
permettraient jamais d’être soumises aux ordres d’un mulâtre…
» Et Grimm ajoute non sans ironie : « Une si importante
considération a fait toute l’impression qu’elle devait
faire. »
Puisque l’on récusait Saint-Georges, à ses yeux le candidat
le plus compétent, Louis XVI, mis au fait de cette cabale,
lui rendit hommage en ne nommant personne. Il prit la
décision de faire administrer L’Académie Royale de Musique
par Papillon de la Ferté, l’un des intendants et trésoriers
de ses Menus Plaisirs. Or, il se trouvait que ce nouveau
responsable de l’Opéra n’était rien d’autre que « l’amant de
cœur » de Madeleine Guimard.
20
Intrigue
Gabriel
Banat s’est demandé si les préjugés raciaux furent la cause
majeure du rejet de Saint-Georges à la direction de
l’Académie Royale de Musique. Le placet en question mit
certes un terme aux aspirations de Saint-Georges d’obtenir le
plus prestigieux poste de France dans le domaine de la
musique. Ce fut probablement pour lui la plus sérieuse
déconvenue de sa carrière.
Saint-Georges se proposait de réorganiser
l’Opéra et les réformes qu’il n’aurait pas manqué d’apporter
firent craindre à ces dames d’être congédiées et remplacées
par d’autres artistes en renom.
En vérité, chaque membre de cette cabale allait tirer profit
de cette intrigue. Les cantatrices furent assurées que le
statut quo serait maintenu. De plus, La Guimard, par
l’intermédiaire de son amant, aurait virtuellement les
pleins pouvoirs à l’Opéra.
21 « Le
Don Juan Noir »
On
a beaucoup parlé du pouvoir de séduction de Saint-Georges
qualifié souvent de « Don Juan Noir ». Le professeur Ribbe
voit dans cette appellation de Bachaumont
une marque de jalousie.
« En attribuant le pouvoir de séduction du Chevalier ni à
sa beauté ni à ses qualités mais à son « talent merveilleux
», autrement dit è ses performances sexuelles, Bachaumont,
un mémorialiste de l’époque, brode sur un fantasme raciste
récurrent qui attribue aux Africains et à leurs descendants
une anatomie à la mesure de leur tempérament, c'est-à-dire
de leur sexualité supposée bestiale. »
Saint-Georges a certainement eu au moins une relation
amoureuse sérieuse, mais le climat raciste qui règne alors
en France lui interdit tout mariage à son niveau social.
22
Le Théâtre musical
Bien
qu'il ait été récusé comme directeur de l'Opéra de Paris,
Saint-Georges va un peu plus tard être appelé à diriger le
théâtre privé de la marquise de Montesson. Chaque semaine,
il donnera deux ou trois représentations. En outre, sur les
instances de la Marquise, épouse de Louis-Philippe, duc
d'Orléans, il est nommé lieutenant des chasses du domaine du
Raincy situé dans la forêt de Bondy où le Duc possède un
château, bâti au XVIIe siècle par l'architecte Le Vau.
Pour Ernestine, sa première comédie musicale
en trois actes, Saint-Georges n'a écrit que la musique. Cet
opéra fut présenté à la Comédie Italienne le 19 juillet
1777. Si la musique fut dans l’ensemble appréciée par les
critiques, en revanche le livret reçut un mauvais accueil.
23
L'apogée
de sa carrière
Claude Ribbe estime que vers 1778, on peut considérer que
Saint-Georges est à l'apogée de sa carrière. Il a publié
deux symphonies concertantes en 1776 et deux autres en
1778. En 1777, il compose trois concertos pour violon et
six quatuors à cordes.
On a parfois surnommé Saint-Georges « Le Mozart Noir »,
appellation que récuse Dominique-René de Lerma, spécialiste
des œuvres de Joseph Bologne et professeur au département de
musique de Lawrence University, dans le Wisconsin.
Pourquoi ne pas faire totale abstraction de ces
considérations de couleur de peau, dit-il ? Si l'on ne peut
s'affranchir de tels préjugés, puisque Saint-Georgess a
influencé l'écriture musicale de Mozart, que n'a-t-on appelé
Mozart dès lors « Le Saint-Georges Blanc ».
En fait, Saint-Georges a toujours été une personnalité
hors du commun dans le monde de la musique classique. C'est
un musicien et compositeur talentueux mais c'est aussi l'un
des meilleurs escrimeurs d'Europe et un colonel héroïque de
la Révolution Française.
Le 12 octobre 1778, Saint-Georges fait jouer pour la
première fois « La Chasse », sa deuxième comédie
musicale. Le public lui réserve un accueil enthousiaste et
il est unanimement encensé par la presse.
24
La Reine Marie-Antoinette
Gabriel Banat souligne que Marie-Antoinette avait reçu une
excellente éducation musicale à Vienne à la cour de
Schönbrunn. Là, avec ses frères et ses sœurs,
Marie-Antoinette suivait journellement un enseignement de
chant et de harpe. Le compositeur Christoph Willibald Gluck
lui donnait des cours de pianoforte. Elle avait une fort
belle voix et pouvait déchiffrer une partition
instantanément. Elle avait acquis une excellente oreille et
éprouvait un réel enthousiasme pour la musique. En
conséquence, elle était devenue la première hôtesse royale à
Versailles depuis Marie de Médicis à non seulement apprécier
la musique mais également à en être une bonne interprète.
Début 1779, Saint-Georges joue de la musique avec la Reine
Marie-Antoinette à Versailles à sa demande et certains
courtisans n'apprécient pas qu'il soit l'un des proches de
la souveraine.
25
Embuscade
nocturne
Dans la nuit du 22 avril 1779, à minuit et demi,
Saint-Georges est victime d’une agression qui a fait l’objet
de plusieurs récits divergents.
Pierre Bardin apporte une version très officielle de cet
épisode dans la mesure où il fait état du rapport de Louis
Michel Roch Delaporte, commissaire du Roi au Châtelet, qui
enregistre la plainte de « Joseph Boulogne Saint-George,
Ecuyer, Capitaine des chasses de son altesse Monseigneur duc
d’Orléans, ayant sa demeure à la Chaussée d’Antin… »
Alors qu’il est sur le boulevard du Temple en compagnie
du baron de Gillier, comte de Saint-Julien, Saint-Georges
déclare avoir été attaqué par « huit ou dix individus
obéissant aux ordres du Sieur Des Brugnières… »
L’un des agresseurs s’en prend à Saint-Georges et lui porte
un violent coup de bâton sur le bras gauche. Saint-Georges
sort alors son épée de son fourreau, « fait sauter le
bâton de l’agresseur et le prend au collet. Une bagarre
générale s’ensuit ».
A ce moment, raconte P. Bardin, Saint-Georges reçoit
l’aide d’un ami, Louis de Lespinasse Langeac, officier de
cavalerie et gouverneur de Carcassonne qui habite non loin
du lieu de l’agression.
26
Un Inspecteur de Police
En même temps
apparaît un homme en uniforme d’exempt de maréchaussée de la
gendarmerie de France. Saint-Georges, respectueux de l’ordre,
lui remet son épée. Des Brugnières le tient alors en respect
en lui pointant un pistolet sur la gorge et demande à ses
gens de lui lier les mains. Tout cela semble providentiel,
voire insolite.
Selon P. Bardin, « à l’évidence, il s’agit d’un coup
monté. « Tous ces gens ont agi et ne se trouvaient pas sur
le boulevard du Temple par coïncidence ».
Saint-Georges exprimera des protestations mais Des
Brugnières parviendra à se justifier avec l’aide de
l’inspecteur de police en proclamant qu’il n’avait pas
pointé son pistolet sur le cou de Saint-Georges mais qu’il
avait simplement sorti son arme après avoir été menacé par
le plaignant, armé d’une épée.
Bref, cet incident d’une extrême confusion fut classé sans
suite.
27 « Erreur sur la personne ! »
P.
Bardin pense tenir l’explication de ce guet-apens nocturne.
Le commanditaire de cette agression serait un acteur
célèbre, nommé Gourgaud dit Dugazon, l’époux de Louise
Rosalie Lefebvre, cantatrice talentueuse, connue sous le nom
de « La Dugazon », qui avait fait ses débuts à Paris dans « Ernestine »,
opéra de Saint-Georges.
Gourgaud, convaincu que son épouse était la maîtresse de
Saint-Georges aurait voulu venger son honneur sans oser
affronter son rival en un duel loyal et pour cause.
P. Bardin précise qu’il y eut en l’occurrence « erreur
sur la personne » car selon toute probabilité, c’est
Lespinasse Langeac qui était l’heureux rival de Gourgaud et
non Saint-Georges comme la rumeur l’affirmait.
Qui plus est, Lespinasse Langeac serait le père d’Alexandre
Louis Gustave, auquel La Dugazon donna naissance et qui fut
baptisé en décembre 1780. Preuve ou forte probabilité en est
que Lespinasse Langeac prendra soin de constituer une rente
viagère annuelle à la dame Dugazon et son fils.
Après cette agression, Saint-Georges choisit de faire jouer
L’Amant Anonyme sur la
scène du théâtre privé de Mme de Montesson en mars 1780. Peu
après il publia deux nouvelles symphonies.
28 La
Révolution Française
Saint-Georges vit à Lille quand éclate la
Révolution en juillet 1789. Il s'engage dans la Garde
Civile un peu plus tard de cette même année. Il obtient le
grade de capitaine en 1790. Le fait d'être militaire, en
garnison à Lille, ne l'empêche pas d'accepter des concerts
et de faire des démonstrations d'escrime. Il écrit même un
opéra, Guillaume-Tout-Coeur ou les Amis de village.
Le livret est de Monnet, un acteur lillois. Il crée cet
opéra 8 septembre 1790.
Les liens de Saint-Georges avec L’Ancien Régime faisaient
maintenant de lui un suspect, c’est pourquoi sur certains
documents d’archives que l’on a découverts, il signe
simplement George.
29 Concerto pour clarinette
Se référant à L’Almanach Musical, Pierre Bardin mentionne
que Saint-Georges composa un concerto pour clarinette qui fut
joué pour la première fois par le célèbre clarinettiste Antonio
Soler et Le Concert Spirituel au Château des Tuileries le
25 mars 1762. Et P. Bardin ajoute :
« Ainsi ce concerto précède celui de Mozart. Fait assez
exceptionnel pour l’époque où l’on ne jouait une œuvre qu’une
fois, ce concerto fit partie du répertoire du Concert Spirituel
et fut joué quatre fois de mars à avril, puis repris le 2
février et le 15 avril 1783, joué par ce même Soler, le soliste
de la Loge Olympique. »
30 « La chevalière d'Eon »
Homme de lettres, juriste, diplomate, écrivain érudit, capitaine
de dragons et héros de « La Guerre de Sept Ans », la vie de d'Eon
a inspiré de nombreux auteurs. C'est un personnage aussi
éclectique que Saint-Georges pouvait l'être mais dans des
domaines différents, l'escrime étant toutefois l'un de leurs
centres d'intérêt communs.
Dans ses jeunes années, d'Eon est beau comme une fille avec un
corps aussi tonique qu'un danseur de l'Opéra.
Le Roi Louis XV a l'idée incongrue de confier à d'Eon la mission
d'approcher la tsarine Elisabeth Prétrovna revêtu de vêtements
féminins pour signer un traité d'alliance.
Envoyé ensuite comme ambassadeur à Londres, il tombe bientôt en
disgrâce et reste en Angleterre où il vit de façon précaire.
Il aurait accepté de porter définitivement des vêtements de
femme à condition que sa pension lui soit restituée afin
notamment d'apaiser les inquiétudes de George III, en proie à
une jalousie morbide. Le Roi d'Angleterre est convaincu que son
épouse, la princesse Sophie-Charlotte de Mecklembourg-Strélitz,
voit d'Eon en secret. C'est du moins une explication, parmi
d'autres, avancée par les historiens.
Opposer deux escrimeurs talentueux, un « Américain des îles »,
au Chevalier d'Eon, devenu « Chevalière », apparaît comme un
spectacle tout à fait original. D'Eon a 59 ans lors de cette
rencontre le 9 avril 1787. Saint-Georges, quant à lui, n'a que
42 ans.
Le
score de l’assaut d’armes qu’ils disputèrent est source de
controverses. Gabriel Banat écrit (page 297 de son livre) que
Saint-Georges ne fut touché qu’une fois par son adversaire et
c’est Saint-Georges qui remporta l’assaut.
On
peut toutefois penser que cet assaut ne fut qu’une démonstration
courtoise d’escrime en présence du Prince du Galles et que
Saint-Georges fut complaisant en s'opposant à un partenaire en
robe.
On
peut rappeler aussi que Saint-Georges n'est déjà plus en
possession de ses moyens physiques. Antoine La Boëssière nous
apprend qu'à l'âge de quarante ans, il a le malheur de se rompre
le tendon d'Achille du pied gauche. Cependant, il a toujours
une bonne main pour parer et riposter. En dépit de son âge, d'Eon,
escrimeur tout aussi exceptionnel que Saint-Georges, n'a jamais
arrêté de s'entraîner. C'est toujours un escrimeur efficace si
l'assaut ne se prolonge pas au-delà de quelques touches.
31 L'influence de Voltaire
Quatre mois après cet assaut d'armes à Londres, Saint-Georges
crée La Fille Garcon à la « Comédie-Italienne ». Une
fois de plus, la plupart des journaux encensent la musique de
Saint-Georges et non le livret écrit par Antoine Eve dit
Desmaillot.
Le
baron Melchior, influencé par les idées racistes de Voltaire met
en doute le talent novateur du Chevalier. S'il estime que
Saint-Georges joue fort bien du violon, en revanche il ose dire
qu'il n'a pas un esprit créatif et il ajoute cyniquement «
qu'il serait contraire à la nature qu'il le fût. » Et il ajoute
: « Cette pièce est mieux écrite qu'aucune autre de Monsieur de
Saint-George. Et néanmoins elle apparaît également dépourvue
d'invention. Ceci rappelle une observation que rien n'a encore
démenti, c'est que si la nature a servi d'une manière
particulière les mulâtres en leur donnant une aptitude
merveilleuse à exercer tous les arts d'imitation, elle semble
cependant leur avoir refusé cet élan du sentiment et du génie
qui produit seul des idées neuves et des conceptions originales.
Claude Ribbe fait remarquer que ce terme « mulâtre » est
péjoratif et offensant au XVIIIe siécle tout comme il peut
l'être de nos jours.
32 « Les Symphonies Parisiennes »
Saint-Georges et le « Concert de la Loge Olympique » jouent pour
la première fois les « Six Symphonies Parisiennes», nos
82-87 de Haydn au cours d'une série triomphale de concerts en
1787. La Symphonie no 85 s'appelle « La Symphonie
de la Reine » parce que c'est la symphonie que préfère
Marie-Antoinette.
33 « Les
Amis des Noirs »
Les
voyages de Saint-Georges à Londres lui permettent d'être
introduit dans les cercles qui militent contre l'esclavage. Il
contribue à la création de la « Société des Amis des Noirs
».
Le 9 août 1789 il met en scène un spectacle musical pour enfants
appelé « Aline et Dupré ou Le Marchand de Marrons ». Il le joue pour
la première fois le 9 août 1788.
Un soir, en janvier 1790, par une nuit sans lune, alors qu'il se
rend seul à pied à une salle de concert à Londres, son étui de
violon sous le bras, un homme le menace d'un pistolet et d'un
bâton dans l'intention de le voler. Il se bat contre le voleur
mais voit surgir alors quatre autres agresseurs qu'il parvient
seul à mettre en fuite.
34 La Révolution Française
Saint-Georges vit à Lille quand éclate la Révolution en juillet
1789. Il s'engage dans la Garde Civile un peu plus tard de
cette même année. Il obtient le grade de capitaine en 1790. Le
fait d'être militaire, en garnison à Lille, ne l'empêche pas
d'accepter des concerts et de faire des démonstrations
d'escrime. Il écrit même un opéra, « Guillaume-Tout-Coeur
ou les Amis de village » (William-All-Heart or the Village
Friends) Le livret est de Monnet, un acteur lillois.
Il crée cet opéra 8 septembre 1790.
Les liens de Saint-Georges avec L’Ancien Régime font maintenant
de lui un suspect, ce qui explique que sur certains documents
d’archives que l’on a découverts, il signe désormais simplement
George.
35 La Légion Saint-George
Officier de la Garde nationale, Saint-Georges devient l'aide de
camp des généraux François de Houx, commandant de Lille et du
général François Miaczynski. Le 1er septembre 1791, une
délégation d'hommes de couleur, conduite par Julien Raimond de
Saint-Domingue, demande à l'Assemblée Nationale de leur
permettre de combattre pour défendre la Révolution et ses idéaux
d'égalité. Le jour suivant, l'Assemblée approuve la formation
d'un corps de troupe, composé essentiellement d'hommes de
couleur avec 800 hommes d'infanterie et 200 cavaliers.
Saint-Georges en devient le chef de brigade avec le grade de
colonel. L'appellation officielle de cette brigade est « Légion
Franche de Cavalerie des Américains et du Midy » mais bien vite
elle est connue de tous sous le nom de « Légion Saint-George ».
L'un
des chefs d'escadron de cette compagnie allait s'illustrer plus
tard dans les armées de la Révolution. Il s'appelle Alexandre
Dumas. Son fils, le célèbre romancier et l'auteur des
Trois Mousquetaires portera le même nom que son père.
Le général Dumas est né à Jérémie, à la pointe ouest de l'île de
Saint-Domingue et tout comme Saint-Georges, il est le fruit des
amours d'une esclave noire, Céssette Dumas, et d'un noble ruiné,
le marquis Davy de la Pailleterie, propriétaire d'une modeste
plantation.
36 Le 13e Régiment de Chasseurs
Les
Autrichiens assiégent Lille et les hommes de Saint-Georges sont
parmi les premiers à combattre. Contrairement à ce que l'on
peut parfois lire, Saint-Georges ne craint pas de monter au feu
et de se porter à la tête de ses troupes alors que son grade de
chef de brigade peut lui éviter de prendre des risques. Les
Autrichiens sont finalement repoussés et Saint-Georges rend
fièrement compte à la Convention de sa victoire. Bientôt
toutefois, les responsables du Ministère de la Guerre décident
de retirer les hommes de couleur de la Légion pour les envoyer
dans les colonies afin de réprimer les insurrections. Cette
brigade prend alors le nom de
« 13e Régiment de Chasseurs ». Des détracteurs de
Saint-Georges, y compris Alexandre Dumas, tentent de dénigrer
Saint-Georges. Ils avancent que la troupe est démoralisée et a
des problèmes d'intendance, notamment en de matière nourriture
et d'équipement.
37 La trahison de Dumouriez
Saint-Georges a joué un rôle crucial pour déjouer la trahison de
Dumouriez à Lille en avril 1793. Le général Charles François
Dumouriez, vaincu à Neerwinden en Belgique en mars, a entamé des
négociations secrètes avec l'Autriche pour marcher sur Paris.
Il entend proclamer le dauphin, Roi de France sous le nom de
Louis XVII. L'armée de Dumouriez s'installe à Maulde à 30 km de
Lille. Miaczinski est envoyé avec 4000 hommes pour établir une
base à Orchies au sud-est de Lille. Le but est de s'emparer de
Lille, Douai et Péronne avant de se diriger vers Paris et de
rétablir le pouvoir monarchique. Dumas et Saint-Georges au
courant de la conjuration envoient un émissaire pour avertir le
commandant de la place de Lille de l'arrivée de Miaczinski qui
arrive à Lille avec une escorte réduite. Celui-ci est arrêté de
son arrivée, conduit à Paris et exécuté le 22 mai 1793. Quant à
Dumouriez, il se réfugie à l'étranger. La République est
sauvée.
38 Prisonnier
Saint-Georges apparaît alors comme un héros mais pas pour
longtemps. Ses liens avec l'aristocratie et son amitié pour le
duc d’Orléans, font de lui un suspect. Plusieurs biographes
présument qu’Alexandre Dumas ne serait pas étranger aux
accusations iniques de malversations qui lui valurent d’être
arrêté le 4 novembre 1793 et incarcéré. Fort heureusement, après
la chute de Robespierre, le Comité de Salut Public reconnaît
qu’il a été destitué injustement. Saint-Georges espère reprendre
son commandement mais n'y parvenant pas, on avance qu’il partit
pour Saint-Domingue.
39 Saint-Domingue
Louise
Fusil, partenaire artistique de Saint-Georges, évoque dans ses
« Souvenirs d’une actrice », ouvrage publié en 1841, sa
joie de retrouver Saint-Georges et son ami Lamothe après une
longue absence.
Elle les accueille par
une vocalise improvisée:
« A la fin, vous voilà! Je vous croyais pendus.
Depuis bientôt deux ans, qu'êtes-vous devenus? »
Et
elle ajoute :
« Non, je ne vous croyais pas précisément pendus mais bien
morts, et je vous ai pris pour des revenants. »
Et
Saint-Georges de lui répondre :
- Nous le sommes, en effet, car nous revenons de loin.
Nous
n’en saurons pas davantage. Louis Fusil n’apporte pas d’autres
précisions et ne mentionne pas que cette absence soit due au
séjour des deux amis sous les cieux de Saint-Domingue. C’est
toutefois à partir de ce témoignage que G. Banat pense qu’il est
très probable que Saint-Georges a séjourné à Saint-Domingue au
moment de l’insurrection des esclaves menée par
Toussaint-Louverture.
En revanche, il est peu probable qu’il ait
fait partie de la délégation des commissaires civils
envoyés à Saint-Domingue avec, à leur tête, Léger-Félicité
Sonthonax, l’ami de Brissot, le fondateur de La Société des
Amis des Noirs.
On n’a trouvé nulle
trace de Saint-Georges dans la presse de l’époque
ou dans les archives des manifestes de
navires en partance des ports français pour Saint-Domingue ou
effectuant des traversées de retour en France.
En
l’absence de preuves pour corroborer cette hypothèse, Pierre
Bardin écrit notamment :
« On prétend qu’après
sa mise à l’écart, Saint-George serait parti à Saint-Domingue,
combattre aux côtés de Toussaint-Louverture. Ceci paraît pour le
moins fantaisiste et ne repose sur aucun document officiel.
Soyons réalistes. Comment imaginer qu’un homme aussi célèbre
aurait pu partir incognito ?
Et il
ajoute : « Louise Fusil dont la sincérité n’est pas mise en
doute, semble mélanger rumeurs et faits réels, ne serait-ce que
par l’inquiétude qu’elle avait ressentie sur le manque de
nouvelles d’être qui lui étaient chers. »
40 Le Cercle de l'Harmonie
Durant
le printemps 1797, Saint-Georges revient à Paris et dirige un
nouvel orchestre « Le Cercle de l'Harmonie » qui s'établit dans
les anciens appartements du duc d'Orléans au Palais-Royal.
Vincent Podevin-Baudin et Laure Tressens, lors d’une exposition
consacrée au Chevalier de Saint-Georges par les responsables des
« Archives Départementales de la Guadeloupe » ont publié un
livre, intitulé Le Fleuret et l'Archet avec pour
sous-titre Le Chevalier de Saint-George, Créole dans le
Siècle des Lumières, citent un article paru sur « Le Mercure
», en date du mois d'avril 1797 selon lequel « les concerts qui
ont déjà eu lieu sous la direction du fameux Saint-George, n'ont
rien laissé à désirer pour le choix des morceaux et la
supériorité de l'exécution. »
41 Anne Nanon retrouvée!
Le 12 février 2015 Pierre Bardin – éminent biographe du chevalier de
Saint-George/s - a fait une communication sensationnelle sur le site :
Généologie et Histoire de la Caraïbe – www.ghcaraibe.org/articles/2015-art01.pdf
Nous vous en proposons ici un compte-rendu parcellaire en vous recommandant de consulter le lien ci-dessus pour une plus ample connaissance des documents que Pierre Bardin a exhumés des archives notariales et de l’état civil sur Anne Nanon, la mère du Chevalier.
* * * *
« De tous ceux qui vécurent à ses côtés, une seule personne, ô combien importante, m’échappait : sa mère Anne Nanon, née sur l’île de la Guadeloupe. Ce n’était pourtant pas faute de l’avoir cherchée. Aujourd’hui, cette lacune peut enfin être comblée. »
C’est par ce préambule que P. Bardin nous conte le cheminement de ses passionnantes recherches. Il a retrouvé l’ultime trace de la mère du chevalier de Saint-George.
Le décès d’Anne Nanon se situe dans un période difficile de la vie du Chevalier. Arrêté le 26 octobre 1793 et envoyé en détention au château d’Hondainville, près de Clermont sur Oise, il ne sera libéré que le 23 octobre 1794 et tente vainement de reprendre le commandement de son
régiment.
« Sans doute las de tous ces revirements, fatigué par sa maladie (ulcère ou cancer de la vessie), à tout le moins désappointé, sinon amer, il va reprendre l’archet. En peu de temps ceux qui le connaissaient diront qu’il n’avait jamais aussi bien joué », écrit Pierre Bardin.
C’est dans ces circonstances que survient la mort de Nanon le 16 décembre 1795. Lorsque Saint-Georges se rend chez le notaire le 29 mars 1796 pour clore la succession de sa mère, Nanon est morte depuis quatre mois. L’acte notarié nous apprend qu’il est le seul et unique héritier de la défunte, ce qui n’est pas surprenant, mais chose déconcertante, sa mère a changé de patronyme. Il n’est plus question désormais d’Anne Nanon mais de la citoyenne Anne Dannevau.
Nous apprenons aussi que Nicolas Benjamin La Böessière, celui qui fut le maître d’armes et le père spirituel du Chevalier, a reçu procuration pour régler la succession.
Bien avant sa mort, Nanon a fait établir cet acte notarié testamentaire en date du 18 juin 1778, signé Anne Danneveau « elle donne et lègue à M. de Bologne St- George, demeurant à Paris rue Saint Pierre, tous les biens, meubles et immeubles qui se trouveront lui appartenir au jour de son décès ».
Selon Pierre Bardin, la rédaction de ce testament montre une volonté délibérée de Nanon, par amour maternel, de se priver de sa véritable identité pour faire oublier la filiation africaine du Chevalier.
Après son mort, les voisins de Nanon rétabliront son identité comme le prouve l’acte de décès en date du 16 décembre 1795 que Pierre Bardin a retrouvé.
L’un de ses voisins, le citoyen Jean Dieudonné Descoings, déclare au juge de paix que « ce jourd’hui à onze heures du matin est décédée la Citoyenne Nannon, âgée d’environ soixante ans, demeurant en sa dite maison au quatrième étage sur le devant… La dite défunte était seule et sans aucun héritier présent… »
Le juge de paix se rend immédiatement à l’adresse indiquée, monte au quatrième étage et pénètre « dans une chambre éclairée grâce à deux croisées donnant sur la rue des Boucheries » où il aperçu sera porté quatre ans plus tard.
Pierre Bardin termine sur une remarque de son épouse » dont « le soutien ne lui a jamais fait défaut » et qui voyant sa perplexité en découvrant ce document lui a dit : « C’est ton nom qui lui a fermé les yeux de Nanon, c’est ton nom qui lui a redonné la lumière. »
42 La mort du Chevalier
Saint-Georges meurt à Paris le 10 juin 1799 d’une infection de
la vessie. Là encore, contrairement à ce qui a pu être écrit, sa
mort est honorée dignement. Une annonce nécrologique, parue sur
Le Journal de Paris en date du 14
juin 1799 encense le Chevalier pour « son urbanité, la
douceur de ses mœurs et la bonté de son âme… », rappelant
les mérites qui furent les siens comme escrimeur, son
excellence dans tous les « exercices du corps » et ses talents
de violoniste virtuose, de directeur d’orchestre et de
compositeur.
Dans son ouvrage biographique, intitulé
The Chevalier de
Saint-Georges: Virtuoso of the Sword and the Bow,
publié en juin 2006, Gabriel
Banat a produit le document officiel du décès de Saint-Georges
en date du 12 juin 1799 (page 484), mentionnant que c'est
Nicolas Duhamel, l'un de ses amis et compagnons d'armes qui a
servi sous les ordres du Colonel Saint-Georges, qui a recueilli
chez lui le Chevalier et l'a assisté durant sa maladie jusqu'à
son décès, survenu le 10 juin 1799. De plus, G. Banat présente à
la page 520 un fac-similé de cet acte de décès.
43 L'exhumation
En janvier
2009, après la publication de sa biographie, P. Bardin a fait
une communication inédite sur le blog de Jean-Claude Halley,
Président de L’Association des Amis de Joseph Bologne, Chevalier
de Saint-Georges [http://halleyjc.blog.lemonde.fr]
après avoir découvert un rapport qui atteste
de l’admiration que les professionnels des armes vouaient au
Chevalier de Saint-Georges. Ce document confirme que cet
éclatant Chevalier n’est pas mort abandonné de tous et oublié.
Cette découverte permet aussi d’apprendre que Saint
George fut inhumé au « Temple de la Liberté et de l’Egalité »
appelée auparavant l’église Sainte Marguerite, débaptisée comme
nombre d’églises sous la Révolution.
Il nous apprend que le 10 juin 1799, le commissaire de police de
la Section de Montreuil reçoit quatre personnages à la mise
soignée : deux maîtres d’armes, Jean-Pierre Gomard et Philibert
Menissier fils, le chef d’escadron Charles François Talmet, et
le citoyen Pierre Nicolas Beaugrand, ancien chef de bureau à
l’Assemblée Nationale. Ils viennent tous quatre déposer
une requête après le décès du citoyen Joseph Bologne dit Saint
George, chef de brigade du treizième régiment de chasseurs à
cheval, dont le corps a été mis en bière et porté en ce jour au
Temple de la Liberté et de l’Egalité, situé au huitième
arrondissement :
« Comme les déclarants ont
connu parfaitement le défunt, qu’ils étaient étroitement liés
d’amitié avec lui, désirent exhumer le corps du dit défunt pour
le mettre dans un cercueil de plomb. Ils se sont donc présentés
devant nous à l’effet de pouvoir parvenir à remplir l’exécution
de leurs sentiments, si toutefois rien n’est contraire au
principe des lois, affirmant le tout pour être sincère
et véritable et ont
signé avec nous après lecture
faite. »
44
Les annonces
nécrologiques
Claude
Ribbe mentionne également que des avis de décès sont insérés
dans les journaux de l'époque et célèbrent le défunt avec
respect et émotion.
Il précise aussi qu'un éditeur de musique a publié des
partitions posthumes du Chevalier, un concerto pour violon et
une série de sonates.
Luc Nemeth fait état d'une brève qui paraît dans
Le
Journal de Paris
le 14 juin 1799 pour signaler le décès de Saint-Georges mais qui
souligne davantage ses mérites dans les « exercices du
corps » - c'est ainsi que l'on appelait alors les disciplines
sportives, les armes, la danse et l'équitation - que ses talents
de violoniste et de compositeur. «
C'est que déjà »,
estime Luc Nemeth, «
le célèbre mulâtre incarnait,
aux yeux de son époque, un passé éloigné. »
45 L'esclavage
La
Convention abolit l'esclavage dans les colonies françaises en
février 1794. L'idéal d'égalité pour lequel Saint-Georges et
ses volontaires de couleur ont combattu si bravement est bientôt
ignoré. Napoléon Bonaparte envoie des troupes à la Guadeloupe
et à Saint-Domingue avec pour mission le rétablissement de
l'esclavage.
Sous la conduite de Louis Delgrès, tous ceux qui se
considéraient désormais comme des Guadeloupéens libres se
révoltent mais le 28 mai 1802 ils sont battus par les troupes du
général Antoine Richepance.
Plutôt que de vivre à nouveau dans les fers de l'esclavage, des
centaines d'insurgés se donnent la mort.
Louis Delgrès, officier noir, colonel des armées de la
Révolution, refuse de se soumettre. Après avoir résisté au fort
Saint-Charles, il gagne la montagne avec trois cents hommes.
Quand les troupes de Richepance l'encerclent plutôt que de se
rendre, il met le feu aux barils de poudre qu'il détient. Il
meurt avec ses hommes dans l'explosion mais provoque aussi la
mort d'un grand nombre de soldats de Richepance.
L'abolition définitive de l'esclavage ne sera effective qu'en
1848. La tentative de reconquête de Saint-Domingue entraîne la
mort de milliers d'insurgés et de soldats commandés par Leclerc,
le beau frère de Napoléon. Les gens de couleur qui vivent en
France souffrent alors de discrimination. Le 29 mai 1802, un
décret officieux met à l'écart tous les officiers de couleur de
l'armée, mettant un terme à la brillante carrière du général
Alexandre Dumas.
46 Le Verdict de l'Histoire
Le
Professeur Ribbe déplore que « les manuels d'histoire disent
bien peu de choses du chevalier de Saint-George ou du million
d'esclaves déportés aux Antilles françaises, que Voltaire soit
honoré comme le plus brillant des humanistes et Napoléon, comme
le plus glorieux des hommes d'état. »
47 Rue du Chevalier Saint-George
Pendant
de nombreuses années, Paris comptait une rue portant le nom de
rue Richepance. En 2001, la ville de Paris a décidé de
rebaptiser cette rue pour en faire la rue Saint-George, à la
demande des citoyens français, originaires des Antilles. La
première plaque commémorative apposée dans cette rue mentionnait
que Saint-George avait été « Colonel de la Garde
Nationale ». L’historien Luc Nemeth a écrit a ce sujet : « On ne
pouvait pas mieux mentir par omission plus de deux siècles après
que le décret de décembre 1792 eut privé le régiment de son
identité, à savoir « La Légion Noire ». Cette première plaque
mentionnait aussi 1739 comme étant la date de naissance du
Chevalier, alors que pour les historiens et les biographes
faisant autorité, la date exacte est 1745. Gabriel Banat, auteur
d’une biographie, intitulée The Chevalier de Saint-Georges:
Virtuoso of the Sword and the Bow (2006), qui est la
référence biographique en anglais, a entrepris de patientes
démarches pour que les plaques de cette rue soient changées. Le
25 mars 2010, le cabinet du Maire de Paris l’a informé de ces
changements.
Monsieur,
Vous avez appelé mon attention sur les plaques signalétiques de
la rue du Chevalier de Saint-George, souhaitant que le texte
soit modifié. Vous voudrez bien trouver ci-joint la photo des
nouvelles plaques qui seront prochainement apposées. Je vous
prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes meilleurs
sentiments.
Philippe LAMY
Les
nouvelles plaques identifient, cette rue comme étant la « Rue du
Chevalier Saint-George » et donnent comme dates « 1745–1799 ».
Elles mentionnent qu’il fut « Colonel de la Légion des
Américains et du Midi », légion composée en majorité de
volontaires noirs que Saint-George commanda.
48 Documentaire : « Le Mozart Noir »
Le
chaîne de télévision TV5 au Québec a, le 10 avril 2003, présenté
un documentaire de 52 minutes intitulé Le Mozart Noir:
Rétablir une Légende.
L'acteur Kendall Knights incarne Saint-Georges au cours de
scènes dramatiques entrecoupées de commentaires historiques et
d'extraits de ses œuvres musicales exécutées par l'Orchestre
Baroque Tafelmusik, dirigé par Jeanne Lamon. Ce documentaire a
été diffusé dans un grand nombre de pays. Site Web :
www.lemozartnoir.com
49 L'Association des Amis de Joseph Bologne,
chevalier de Saint-Georges
Le siège de
L’Association des Amis
de Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, présidée par
Jean-Claude Halley est en Guadeloupe.
E-mail :
halleyjc@wanadoo.fr
50 Les Partitions
Les
partitions du chevalier de Saint-Georges sont disponibles
à :
www.artaria.com
et
http://www.omifacsimiles.com/cats/minkoff.html
51 Bibliographie
Archives Départementales de la Guadeloupe. Le Fleuret et
l'Archet : Le Chevalier de Saint-George, Créole dans le Siècle
des Lumières, Bisdary - Gourbeyre, 2001.
Banat, Gabriel. Le Chevalier de
Saint-George: Virtuoso of the
Sword and the Bow, Pendragon Press, 2006.
Bardin, Pierre. Joseph de Saint-George, le Chevalier Noir.
France : Guénégaud, 2006.
Everyman’s Dictionary of Music, compilation de Eric Bloom,
revise par Jack Westrup, Professeur de Musique,
Oxford University. New York: New American Library, 1971.
Guédé, Alain. Monsieur de Saint-George : Le nègre des
Lumières. Arles, Actes Sud, 1999.
Harvard Biographical Dictionay of Music, publié par Don Michael
Randel, Cambridge, Massachussetts & Londres, Angleterre :
Belknap Press of Harvard University Press, 1996.
Marciano, Daniel. Le chevalier de Saint-George, le
fils de Noémie. France : Thespis, 2005.
Microsoft Encarta Africana Encyclopedia, sur CD-ROM et dans
un livre publié par Basic Civitas Books. Kwame Anthony Appiah
et Henry Louis Gates, Jr., Redacteurs.
Nemeth, Luc. Un État-Civil Chargé D'Enjeux : Saint-George,
1745-1799. Annales historiques de la Révolution française,
2005, N° 1.
Ribbe,
Claude. Le chevalier de Saint-George. France : Perrin,
2004.
Smidak,
Emil F. Joseph Boulogne nommé Chevalier de Saint-George.
Lucerne : Avenira 1996.
52 Un
contemporain atypique de
Mozart : Le Chevalier de Saint-George ;
Michelle Garnier-Panafieu ;
YP Éditions (2011)
Saint-George, compositeur : l’excellence de sa
musique instrumentale qui privilégie le violon
Rhétorique et composition
Son
style se fonde sur des procédés rhétoriques qui, relevant de l’imitation de la
nature prônée au XVIIIe
siècle par les philosophes (de Du Bos à Chabanon) et les théoriciens de la
musique (de Brijon à Cambini), font référence au Chant comme élément
essentiel de l’écriture. Au modèle vocal et à ces procédés (répétition,
périodicité, alternance, contraste, variété) utilisés pour structurer le
discours et exprimer les passions s’ajoutent des influences françaises (art
chorégraphique, style sentimental et romance), italiennes (virtuosité
violonistique) et allemandes (Ecole de Mannheim, Sturm und Drang).
L’apanage des concerts privés : quatuors à
cordes et sonates
Il
fit ses armes de compositeur dans le genre novateur du quatuor à cordes
dont il fut l’un des principaux protagonistes (dix-huit en trois opus :
Œuvre I en 1773, 2e
Livre en 1778, Œuvre 14 en 1785). En deux mouvements (du type
Allegro – Rondeau ou Aria con variazione) caractérisés par
une thématique souple, gracieuse, souvent teintée de mélancolie et par des
Rondeaux pleins de vivacité (où alternent modes majeur et mineur),
ils illustrent le quatuor concertant où abondent les Soli.
Orfèvre dans sa musique de chambre élégante et
raffinée (citons ses Sonates Pour Le Clavecin ou Forté Piano avec
Accompagnement de Violon Obligé, de style galant, 1781, et ses brillantes
Sonates pour le Violon – deux violons – 1799), il exprima
magnifiquement la spécificité de son style dans ses œuvres orchestrales.
A la conquête du concert public : symphonies
concertantes, symphonies, concertos pour violon
S’il
fut l’un des meilleurs représentants de la symphonie concertante, genre
typiquement français (huit entre 1775 et 1782 : deux Œuvre VI,
deux Œuvre IX, deux Œuvre
X, une
Œuvre
XII, une Œuvre
XIII, destinées à deux violons
principaux auxquels s’adjoint un alto dans l’Œuvre
X et majoritairement en
deux mouvements Allegro –
Rondeau d’allure vaudevillesque),
il contribua aussi à l’épanouissement de la symphonie (deux Œuvre XI, la
seconde étant l’ouverture de L’Amant anonyme).
Mais
ce sont ses quatorze concertos « à violon principal », composés pour son propre
usage et publiés entre 1773 et 1778 (citons les
Œuvres II, III, IV, V,
VII, VIII) sauf le dernier,
posthume, en 1799, qui témoignent le mieux de sa technique hardie et pleine
d’éclat (batteries, grands écarts mélodiques, contrastes de registres).
Instrumentés pour cordes et vents (deux flûtes, deux hautbois et deux cors ad
libitum), ils adoptent le plan vivaldien (Allegro où alternent
Tutti et Soli, Adagio ou Largo expressif et
influencé par l’écriture lyrique, Rondeau).
Théâtre lyrique et musique vocale : un domaine peu exploré
Si
ses comédies à ariettes sont mal connues (sauf pour L’Amant anonyme, on
n’en possède pas de partition complète), ses airs et romances jouirent d’une
grande vogue dans les salons comme celui de Madame de Chambonas. Une Chanson
de l’opéra de M. de St.-George
(« Soir et matin sur la fougère », extraite de La Chasse) figure dans un
recueil de Grénier, maître de harpe de Marie-Antoinette, vers 1783 (p. 31-33 et
Documents Nos
4 à 6b).
Son Œuvre musical relève encore du domaine de la
Recherche. Il fut bien l’un des meilleurs représentants de l’esthétique
concertante des Lumières et l’un des maillons essentiels de la chaîne
musicale qui, de Rameau à Berlioz, assura la transition du Baroque au Romantisme.
Professeur Michelle Garnier-Panafieu
Musicologue, Université Rennes II
Droit d'auteur
Cette page a été mise à jour le
01/01/16